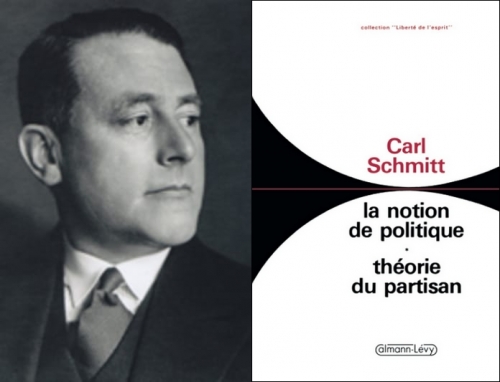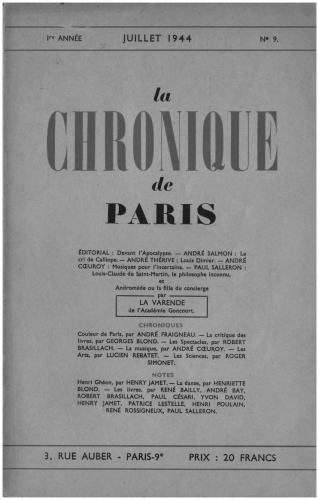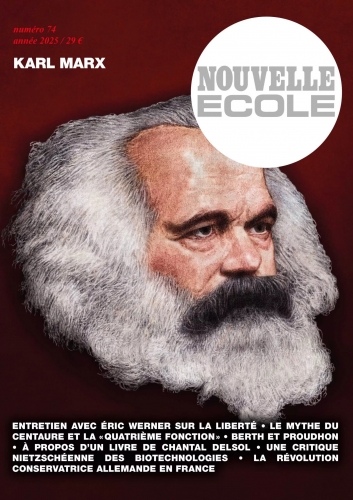Le laboratoire britannique de la persécution idéologique. Bientôt chez nous ?
Il est un peu plus de huit heures au bar des Brisants, à Lechiagat. La nuit s’est retirée sans fracas, laissant derrière elle cette clarté grise et salée que connaissent bien les ports de l’Atlantique. La mer est basse, étalée comme une grande table de métal terne, et les chalutiers, ventrus et silencieux, sont retenus par des amarres fatiguées. Le café est brûlant, presque agressif, et nécessaire. Autour de moi, les habitués parlent peu. On ne parle jamais beaucoup ici le matin. On écoute le vent, on jauge le ciel, on attend.
Sur la table, mon téléphone éclaire le bois usé. J’y lis The Telegraph. Une lecture qui, d’ordinaire, m’accompagne comme un exercice d’hygiène intellectuelle, cette vieille presse britannique ayant longtemps conservé le goût des faits et le sens de la continuité historique. Ce matin-là, pourtant, l’article me saisit à la gorge. Il raconte l’histoire d’un professeur de sciences politiques, dans un collège anglais, littéralement broyé pour avoir fait son métier, montrer, expliquer, contextualiser. Son crime tient en peu de mots, avoir diffusé à ses élèves des vidéos de Donald Trump, discours d’investiture, extraits de campagne, documents publics accessibles à tous .
Les faits sont d’une banalité confondante. L’homme, quinquagénaire, enseigne à des élèves de dix-sept et dix-huit ans, des élèves presque adultes, appelés à voter dans peu de temps. Le programme porte sur la politique américaine, la propagande, les mécanismes électoraux. Trump vient de remporter l’élection. Le professeur montre quelques vidéos, y compris des documents issus du camp démocrate. Rien de clandestin, rien d’idéologique au sens militant. Et pourtant, tout bascule à partir de presque rien, deux plaintes d’élèves évoquant un « malaise », un « inconfort émotionnel ».
Dans le monde ancien, ce genre de plainte aurait donné lieu à un échange, un rappel de cadre, peut-être une explication supplémentaire. Dans le monde nouveau, elle devient un signal. Et le signal déclenche la machine. L’émotion, subjective par nature, est immédiatement traitée comme un fait objectif. Puis comme un fait administratif. Puis comme un fait potentiellement pénal. La vérité disparaît au profit de la procédure.
L’administration du Henley College agit avec une célérité qui force l’admiration, si elle n’était si sinistre. Aucun doute, aucune hésitation, aucune protection de son enseignant. Des courriels officiels tombent, accusant un enseignement « biaisé », « hors sujet », puis un « préjudice émotionnel ». Le vocabulaire est soigneusement choisi, suffisamment flou pour englober tout et son contraire, suffisamment grave pour justifier l’escalade. Le professeur n’est plus un collègue, il devient un problème à gérer.
Vient alors l’intervention du Local Authority Designated Officer, ce rouage discret mais essentiel de la nouvelle gouvernance morale britannique. Dans son rapport, il n’est plus question de faits, mais de perceptions. Les opinions du professeur « pourraient être perçues comme radicales ». Cette phrase mérite d’être relue lentement. Elle ne dit rien de ce qui est, tout de ce qui pourrait être imaginé. Le conditionnel règne. Sur cette base, la recommandation tombe, un signalement au programme Prevent est jugé prioritaire.
Prevent. Ce mot, conçu pour désigner la lutte contre le terrorisme islamiste, se retrouve ici mobilisé contre un professeur montrant des vidéos d’un président démocratiquement élu. Le glissement est total. L’outil change de fonction sans changer de nom. Il ne s’agit plus de prévenir la violence physique, mais de neutraliser la dissidence symbolique. L’enseignant est assimilé, de manière implicite mais implacable, à un risque terroriste potentiel.
À aucun moment l’administration scolaire ne s’interpose. À aucun moment elle ne rappelle l’évidence, enseigner la politique suppose d’exposer à des discours politiques. Elle n’oppose pas la raison à l’absurde. Elle applique, elle transmet, elle se protège. La lâcheté institutionnelle s’avance ici à visage découvert. L’enseignant est poussé vers la sortie, psychologiquement brisé, contraint d’accepter une indemnité dérisoire pour préserver ce qu’il lui reste de dignité.
Au bar des Brisants, quelqu’un parle du prix du gasoil, un autre d’un coup de vent annoncé trop fort pour les petits bateaux. Je continue de lire. Le professeur raconte les nuits sans sommeil, les consultations chez un psychologue, l’effondrement intime. La bureaucratie, elle, ne voit rien de tout cela. Elle n’a ni yeux ni mémoire. Elle n’a que des cases à cocher.
Ce qui se joue ici dépasse de loin le sort individuel de cet homme. Le Royaume-Uni fonctionne depuis des années comme un laboratoire avancé de la censure procédurale. La gauche militante, profondément installée dans l’appareil éducatif et administratif, n’a plus besoin d’interdictions brutales. Elle a compris la puissance des dispositifs. Protection de l’enfance, bien-être émotionnel, lutte contre la radicalisation. Des concepts mous, extensibles à l’infini, impossibles à contester sans être aussitôt suspect.
Carl Schmitt écrivait que le politique commence avec la désignation de l’ennemi. Dans cette affaire, l’ennemi n’est plus celui qui agit, mais celui qui dévie. Il n’est plus combattu, il est pathologisé. On ne débat pas avec lui, on le neutralise pour sa propre sécurité et celle des autres. La morale remplace le droit. La peur remplace le jugement.
Je pense à Guillaume Faye, à sa critique de la tyrannie du Bien, à cette idée que les sociétés terminales préfèrent détruire à bas bruit plutôt que d’assumer la répression ouverte. Ici, rien de spectaculaire. Aucun procès public. Seulement une succession de lettres, de rapports, de recommandations. Une carrière dissoute dans l’acide administratif.
Depuis la Bretagne, face à l’Atlantique, cette affaire résonne comme un avertissement. Ce que les Britanniques expérimentent aujourd’hui arrive toujours chez nous demain. Les mêmes mots, les mêmes dispositifs, les mêmes lâchetés. La France aime se croire protégée par son esprit critique. Elle oublie que ses administrations et les syndicats d’enseignants partagent la même passion pour la procédure et le conformisme.
Et l’actualité récente vient donner à cette intuition une résonance plus large encore. Au moment même où je referme l’article du Telegraph, une autre lecture s’impose, celle des déclarations de Pavel Durov, fondateur de Telegram. Dans une série de messages d’une virulence rare, il accuse Emmanuel Macron et l’Union européenne de vouloir instaurer ce qu’il appelle sans détour un « goulag numérique » .
Le mot est brutal, volontairement excessif diront certains. Il convoque une mémoire lourde, celle de l’enfermement administratif, de la déshumanisation par le système. Durov n’est pourtant ni un marginal ni un provocateur sans poids. Il est un acteur central du numérique mondial, naturalisé français, longtemps célébré par les élites avant de devenir leur accusateur. Son diagnostic est clair. Sous couvert de régulation, de lutte contre la haine et la désinformation, l’Europe met en place un arsenal juridique destiné à surveiller, filtrer, contraindre les discours.
Le Digital Services Act, le projet Chat Control, les injonctions adressées aux plateformes, tout cela forme un continuum. Le lien avec l’affaire du professeur britannique apparaît alors avec une évidence presque cruelle. Dans les deux cas, le procédé est identique. On ne censure plus frontalement. On encadre, on classe, on transforme l’opinion en risque. À Henley-on-Thames, ce sont les protocoles de safeguarding et Prevent. À Bruxelles et à Paris, ce sont les règlements numériques et les autorités dites indépendantes. Même logique, même finalité.
Je repense à cette phrase d’Emmanuel Macron, rappelée par Durov, selon laquelle les citoyens auraient tort de s’informer sur les réseaux sociaux et devraient se fier aux médias traditionnels. Elle trahit une défiance profonde envers le jugement des peuples. Une tentation ancienne, confier la vérité à des instances autorisées. Schmitt, encore lui, rappelait que le libéralisme finit toujours par produire son contraire lorsqu’il cherche à neutraliser le conflit. La neutralisation devient domination.
L’Union européenne, qui se voulait espace de circulation et de liberté, se transforme peu à peu en espace normatif saturé, où chaque parole laisse une trace, chaque contenu appelle une modération, chaque divergence devient suspecte. Le professeur britannique est sanctionné au nom de la protection des élèves. Le citoyen européen de demain sera surveillé au nom de sa sécurité numérique. Les motifs changent. La méthode demeure.
Au bar des Brisants, je termine mon café. Le vent s’est levé. Les amarres grincent, les coques s’entrechoquent doucement. Ici, en Bretagne, on sait ce que valent les systèmes trop rigides face aux forces profondes. Ils rompent toujours. L’injustice subie par un enseignant anglais et les accusations lancées par un entrepreneur du numérique ne sont pas des anecdotes isolées. Elles dessinent une même ligne de faille, celle d’un pouvoir qui ne supporte plus ce qui lui échappe.
Guillaume Faye parlait de convergence des catastrophes. Peut-être faut-il aujourd’hui parler de convergence des censures. L’une éducative, l’autre numérique, toutes deux bureaucratiques, toutes deux persuadées d’agir pour le Bien. À ceux qui croient encore que ces dispositifs ne viseront que les autres, l’histoire britannique offre une réponse sans appel. La mer monte toujours plus vite qu’on ne le croit.
Balbino Katz (Breizh-Info, 27 décembre 2025)